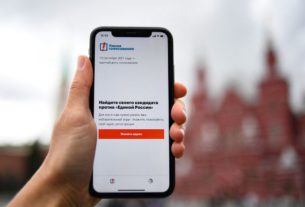Survivre à un crash d’avion dépend de nombreux facteurs pas toujours explicables par la science.
Prenant prétexte du récent accident du vol 2216 de la compagnie sud-coréenne Jeju Air le dimanche 29 décembre 2024, le Wall Street Journal (WSJ) tente de percer le mystère de ces catastrophes aériennes à première vue apocalyptiques, mais dont ressortent tout de même des survivants.
À l’instar des deux membres de l’équipage de ce Boeing 737-800 – sur un total de 181 passagers – embrasé par le feu après son atterrissage – sans ses trains de frein – sur le tarmac de l’aéroport de Muan, au sud-ouest de la Corée du Sud, quelques autres miraculés ont été enregistrés lors d’accidents similaires ces dernières années.
La Flight Safety Foundation, organisme international à but non lucratif spécialisé dans la fourniture de conseils en matière de sécurité, dénombre ainsi 17 cas de crashs impliquant des avions de plus de 80 passagers, avec un ou deux survivants, au cours des huit dernières décennies.
Une éminemment science complexe
Un ratio malheureusement bien maigre, mais qui contribue à épaissir le mystère autour de ces survivants. D’où le concept de « survivabilité » utilisé dans le milieu par les enquêteurs afin d’évaluer si un accident offrait théoriquement des chances de survie aux occupants.
À cet effet, le WSJ indique que cinq facteurs sont principalement pris en compte : l’intégrité de l’appareil, l’efficacité des dispositifs de retenue, l’environnement dans la cabine, les facteurs post-crash comme l’incendie ou la fumée et les forces G subies par les occupants.
Les forces G connues comme une mesure des forces gravitationnelles ou d’accélération qui s’exercent sur un corps, jouent un rôle crucial. Nous subissons dans la vie quotidienne sur terre, une force de 1 G, tandis qu’un être humain perd généralement conscience entre 4 et 5 G.
Selon les professeurs Thomas Zeidlik et Nicholas Wilson de l’Université du Dakota du Nord interrogés par le quotidien américain, les occupants ont une chance raisonnable d’échapper à des blessures graves si l’avion ne subit pas plus de 9 G en mouvement avant.
La chance comme variable
Des zones de déformation, similaires à celles des voitures, sont intégrées aux avions modernes pour aider à absorber ces forces. Comme le montre le cas des deux survivants du vol 2216 – assis à l’arrière –, la position des passagers lors d’un crash peut s’avérer déterminante dans leurs chances de survie.
Même si les experts soulignent qu’il n’existe pas de place miracle. Si l’arrière semble statistiquement plus sûr, tout dépend de la manière dont l’avion s’écrase. En cas d’impact frontal, les passagers avant subissent le plus gros choc, mais en cas d’incendie, la proximité des issues de secours peut se révéler déterminante.
Reste que la rationalité n’est pas toujours de mise. Le Wall Street Journal rappelle ainsi le cas d’un McDonnell Douglas DC-9 qui s’est écrasé peu après le décollage à Detroit en 1987, avec une épave dispersée sur plus de 900 mètres et tous les sièges passagers détachés.
Parmi les 155 personnes victimes de cet accident décrit comme « non survivable », figurait une fillette de quatre ans retrouvée saine et sauve dans les débris. « Je n’aime pas utiliser ce terme, mais parfois la chance entre en jeu« , confie Anthony T. Brickhouse, expert en sécurité aérospatiale et professeur à l’université Embry-Riddle.